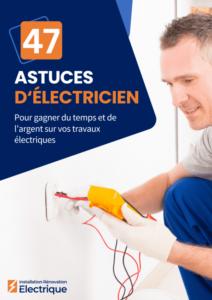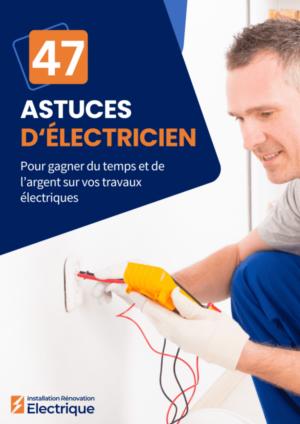Les députés rétablissent le taux réduit de TVA sur l’électricité : entre geste social, risque européen et stratégie énergétique

Résumez cet article :
Un vote qui relance le débat sur la fiscalité de l’énergie
Jeudi 20 novembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le retour au taux réduit de TVA à 5,5 % sur l’abonnement d’électricité, malgré l’opposition du gouvernement. Un vote symbolique, qui intervient dans un contexte de forte tension autour des prix de l’énergie et des marges de manœuvre fiscales de la France.
L’amendement, porté par Emmanuel Maurel, remet en cause l’interprétation du gouvernement de la jurisprudence européenne. Selon lui, la directive européenne ne prohibe pas explicitement la possibilité d’appliquer des taux de TVA différents entre l’abonnement et la consommation. Le député en tire une conclusion simple : rien n’empêcherait la France de revenir au taux réduit, historiquement appliqué sur la partie fixe des factures.
Une interprétation européenne qui divise
Pour l’exécutif, la décision est trop risquée. La hausse à 20 % votée dans le budget 2025 faisait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, indiquant qu’une prestation unique ne peut être fractionnée en plusieurs taux de TVA. Électricité consommée et électricité disponible via l’abonnement constitueraient, dans cette logique, un service unique.
Le gouvernement redoute donc un retour de bâton juridique. Une procédure d’infraction, et potentiellement une sanction financière, pourraient contraindre la France à harmoniser la TVA sur l’ensemble de la facture. Ce scénario conduirait mécaniquement à appliquer le taux de 5,5 % sur la consommation elle-même, avec un coût estimé à plusieurs milliards d’euros.
Dans ce contexte, Philippe Juvin, rapporteur LR, évoque une mesure :
- « au minimum à 900 millions d’euros »,
- mais « plus vraisemblablement à cinq milliards » si Bruxelles exige l’uniformisation des taux.
Une mesure jugée mal ciblée par l’exécutif
La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a rappelé que la baisse bénéficierait à « 98 % des Français », indépendamment de leurs revenus. Le geste fiscal avantagerait ainsi autant un ménage modeste qu’un foyer aisé, dès lors qu’ils possèdent tous deux un abonnement de puissance similaire.
Pour l’exécutif, le véritable outil de justice sociale demeure le chèque énergie. Celui-ci représente 650 millions d’euros distribués chaque année à environ six millions de ménages.
Selon la ministre, il s’agit d’un dispositif « ciblé », contrairement à une baisse de TVA généralisée.
Ainsi, pour le gouvernement, les arguments en défaveur de l’amendement sont de plusieurs ordres :
- risque juridique européen,
- coût budgétaire potentiellement massif,
- efficacité sociale contestée.
Le gouvernement privilégie une stratégie industrielle
Un autre élément, plus structurel, explique la position du gouvernement. Celui-ci veut concentrer ses efforts sur les entreprises, et notamment sur les TPE, les artisans et les industries non électro-intensives, fortement fragilisés par l’envolée des prix.
La France souffre d’un handicap énergétique majeur :
- l’électricité y est actuellement deux fois moins chère aux États-Unis,
- et quatre fois moins chère en Chine.
Cette asymétrie alimente un risque de déclassement industriel, que l’exécutif veut endiguer. La ministre a donc ouvert la voie à des mesures destinées à réduire durablement le coût de l’énergie pour les entreprises, probablement dans le cadre du budget 2026.
Une suite parlementaire incertaine
Le sort de l’amendement reste incertain. Le Sénat, généralement attentif aux équilibres budgétaires, pourrait s’y opposer. Le gouvernement conserve en outre la possibilité d’utiliser le 49.3 lors de l’adoption finale du budget, ce qui ferait disparaître le dispositif.
La question de la conformité européenne demeure également en suspens. Une mise en demeure de la Commission pourrait suffire à annuler le geste voté par l’Assemblée, ouvrant un nouveau cycle de contentieux entre Paris et Bruxelles.
Une question technique qui devient politique
Derrière une apparente technicité fiscale, le débat révèle une tension fondamentale : faut-il privilégier un allègement immédiat des factures des ménages, ou concentrer les moyens publics sur la compétitivité des entreprises dans un marché mondial profondément déséquilibré ?
Le vote du 20 novembre illustre cette fracture. Il met en lumière la difficulté croissante à concilier justice sociale, impératifs européens et stratégie industrielle. Dans un pays où l’électricité est devenue un marqueur central du pouvoir d’achat, chaque décision budgétaire prend désormais la forme d’un choix politique majeur.
Résumez cet article :