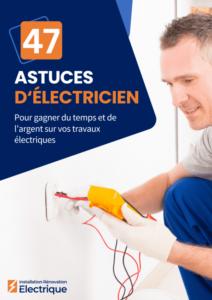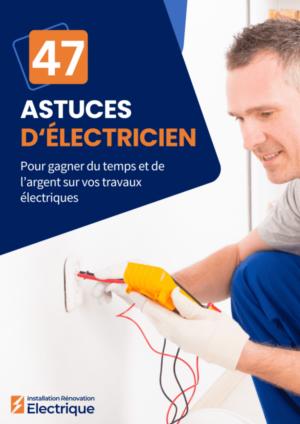Faut-il s’attendre à une flambée durable du prix de l’électricité en Europe ?

Résumez cet article :
Alors que l’Union européenne a décidé d’interrompre progressivement ses importations de gaz russe, le marché de l’énergie entre dans une phase de mutation profonde. Cette réorientation stratégique, motivée par des considérations géopolitiques et climatiques, aura des répercussions directes sur le coût de l’électricité dans les années à venir. Entre tensions d’approvisionnement, hausse des coûts de production et investissements massifs dans les infrastructures, tout laisse penser que le prix du kilowattheure est appelé à grimper. Océane Latour, Directrice Générale de la société Eco-énergie, spécialisée dans le courtage énergétique, nous aide à y voir plus clair.
1. Le tournant géopolitique : la fin du gaz russe
Le 20 octobre 2025, les ministres de l’énergie de l’Union européenne ont adopté une position commune : interdire tout nouveau contrat d’importation de gaz russe à partir de 2026 et supprimer progressivement les contrats existants d’ici 2028.
Le Parlement européen pousse même pour une interdiction totale dès le 1er janvier 2026.
Cette décision s’inscrit dans la logique du plan REPowerEU, lancé après l’invasion de l’Ukraine, visant à réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles russes. En parallèle, un accord transatlantique massif prévoit près de 800 milliards de dollars d’achats d’énergie (gaz, pétrole, GNL, uranium) aux États-Unis d’ici 2028.
Cette bascule stratégique est lourde de conséquences : le gaz russe, historiquement peu coûteux et acheminé par pipeline, sera remplacé par du gaz liquéfié (GNL), plus cher à transporter, plus complexe à stocker et plus exposé aux variations du marché mondial.
2. L’effet domino : du gaz au prix de l’électricité
Même si le gaz ne représente pas la seule source de production d’électricité en Europe, il reste un pilier central du mix énergétique, notamment pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables.
Or, le coût de l’électricité sur les marchés européens dépend largement du prix de la dernière centrale appelée — souvent une centrale à gaz.
En clair :
👉 Si le gaz devient plus cher, le prix de l’électricité suit immédiatement.
👉 Si l’approvisionnement devient plus incertain, la volatilité du marché augmente.
Ainsi, la fin du gaz russe ne signifie pas seulement une tension sur les factures de gaz, mais aussi une pression durable sur le prix du MWh électrique.
3. Le GNL : une alternative coûteuse et instable
Pour compenser la chute des importations russes, l’Europe mise sur le gaz liquéfié américain, qatari ou africain.
Mais cette solution a un prix.
-
Le coût de production et de transport du GNL est 20 à 30 % plus élevé que celui du gaz russe livré par pipeline.
-
Les infrastructures nécessaires — terminaux méthaniers, capacités de regazéification, réseaux d’acheminement — nécessitent des investissements colossaux.
-
La concurrence asiatique (notamment la Chine et le Japon) sur le marché du GNL renforce la tension sur les prix spot, en particulier lors des pics hivernaux.
Résultat : une hausse mécanique des coûts de production électrique, difficilement compressible à court terme.
4. Les effets d’entraînement sur le marché européen
a) Une électricité plus chère à produire
Les centrales à gaz, sollicitées pour équilibrer la production renouvelable, verront leur coût de fonctionnement grimper.
Même si l’électricité solaire et éolienne est moins coûteuse à long terme, la dépendance au gaz pour la stabilité du réseau (notamment la production en pointe) reste forte.
b) Une infrastructure sous tension
Les réseaux de transport et de distribution devront s’adapter à la nouvelle géographie énergétique : davantage d’importations maritimes, plus de régulation, plus de flexibilité.
Ces adaptations structurelles — interconnexions, stockage, pilotage numérique — sont coûteuses et finiront par se répercuter sur les factures.
c) Une demande croissante d’électricité
L’électrification de nombreux usages (mobilité, chauffage, industrie) crée une hausse structurelle de la demande.
Avec moins de gaz bon marché et plus d’électrification, le système risque d’être sous tension, accentuant encore la pression haussière sur les prix.
5. Quelles sont les conséquences pour les consommateurs et les entreprises ?
Pour les particuliers
-
Les tarifs réglementés risquent de subir de nouvelles hausses entre 2026 et 2028, après une relative accalmie post-crise de 2022.
-
Les offres à prix variable deviendront plus risquées, car elles suivront les fluctuations du marché de gros.
-
La sobriété énergétique et l’investissement dans l’autoproduction (photovoltaïque, pompe à chaleur) deviennent des leviers d’anticipation.
Pour les entreprises
-
Les industries énergivores (métallurgie, chimie, agroalimentaire) seront les plus exposées.
-
Les contrats à long terme devront être renégociés avec prudence, en intégrant des clauses de flexibilité et de plafonnement.
-
Un audit énergétique devient indispensable pour identifier les postes les plus coûteux et définir une stratégie de résilience.
6. Nos recommandations stratégiques
-
Sécuriser son prix d’achat : privilégier des offres à prix fixe sur plusieurs années, lorsque les conditions le permettent. Si vous souhaitez renégocier vos contrats en tant que particulier ou professionnel, vous pouvez contacter Océane Latour sur son mail oceane.l@eco-energie.co si vous souhaitez challenger vos fournisseurs actuels. Du côté de la rédaction, Océane a réussi à nous négocier des tarifs avantageux, entre 30 et 40% de réduction, alors qu’on pensait être « ceinture et bretelles ».
-
Améliorer son efficacité énergétique : isolation, gestion intelligente de la consommation, pilotage domotique. Retrouvez notre guide Comment réduire vos factures d’électricité
-
Investir dans la production locale : autoconsommation photovoltaïque, micro-éolien, stockage.
-
Anticiper les tensions de réseau : plan de continuité pour les entreprises, alternatives de secours (groupes électrogènes, batteries).
-
Surveiller les signaux politiques et réglementaires : le futur marché européen de l’électricité, en cours de réforme, pourrait redéfinir la tarification et les marges de manœuvre des fournisseurs.
7. Les limites et contrepoids possibles
Tout n’est pas noir :
-
L’accélération du déploiement des renouvelables pourrait stabiliser les prix à moyen terme.
-
Les interconnexions européennes renforcées permettront une meilleure mutualisation des ressources.
-
De nouvelles formes de contrats d’électricité verte à long terme (PPA) se développent, garantissant un prix stable et une traçabilité environnementale.
Cependant, la transition aura un coût, et les années 2026 à 2028 s’annoncent comme une période de turbulences tarifaires avant un éventuel retour à l’équilibre.
8. Vers une ère de l’électricité sous tension ?
L’Europe entre dans une nouvelle ère énergétique, marquée par l’indépendance, la transition et… la volatilité.
La fin du gaz russe bouleverse les équilibres économiques établis depuis deux décennies. Entre le coût du GNL, la montée de la demande et la transition vers les renouvelables, le prix de l’électricité pourrait augmenter de 15 à 30 % d’ici 2028, selon plusieurs projections concordantes.
Ce n’est pas une fatalité : les acteurs qui anticiperont ces mutations — en investissant dans la sobriété, l’efficacité et la production locale — limiteront l’impact de cette nouvelle donne énergétique.
À retenir :
L’électricité devient une ressource stratégique, dont le prix ne dépend plus seulement de la météo, mais de la géopolitique mondiale.
Se protéger aujourd’hui, c’est investir dans son autonomie énergétique de demain.
FAQ — Hausse du prix de l’électricité en Europe
1. Pourquoi le prix de l’électricité risque-t-il d’augmenter dans les prochaines années ?
La principale raison est la fin des importations de gaz russe décidée par l’Union européenne. Le gaz étant encore utilisé pour produire une part importante de l’électricité, son remplacement par du gaz liquéfié (GNL) plus cher entraîne une hausse mécanique des coûts de production électrique.
2. Le gaz russe représente-t-il une part si importante de notre électricité ?
Indirectement, oui. Le gaz alimente les centrales thermiques utilisées pour équilibrer la production intermittente des énergies renouvelables. Sa disparition comme ressource bon marché renchérit le coût marginal de production de l’électricité sur les marchés européens.
3. Le gaz liquéfié (GNL) ne peut-il pas remplacer efficacement le gaz russe ?
Techniquement, oui, mais économiquement, non. Le GNL est plus coûteux à produire, transporter et stocker. De plus, il dépend d’un marché mondial concurrentiel (avec l’Asie notamment), ce qui rend les prix plus volatils et imprévisibles.
4. L’électricité solaire et éolienne ne permettront-elles pas de faire baisser les prix ?
À long terme, oui — mais à court et moyen terme, la dépendance aux centrales à gaz pour stabiliser le réseau reste inévitable. La montée en puissance des renouvelables exige aussi des investissements dans les réseaux, le stockage et la flexibilité, ce qui pèse temporairement sur les coûts.
5. Quelles sont les conséquences pour les particuliers ?
Les factures risquent d’augmenter de 10 à 30 % d’ici 2028, selon les estimations. Les offres à tarif variable seront plus risquées. Il devient stratégique d’investir dans la sobriété énergétique et dans l’autoconsommation (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.).
6. Et pour les entreprises ?
Les entreprises à forte consommation énergétique doivent renégocier leurs contrats, réaliser des audits de consommation, et envisager des contrats d’électricité verte à long terme (PPA). Une stratégie proactive peut amortir les hausses à venir.
7. L’Union européenne peut-elle contenir cette hausse ?
L’UE agit pour limiter les effets de la transition : réformes du marché de l’électricité, mutualisation du stockage, subventions aux ménages, et soutien aux énergies renouvelables. Toutefois, la période 2026–2028 restera économiquement tendue, car la réorganisation énergétique est structurelle.
8. Que peut-on faire dès maintenant pour se protéger ?
-
Vérifier la nature de son contrat (fixe ou variable)
-
Réduire la consommation via des équipements performants
-
Installer des sources locales de production (photovoltaïque, pompe à chaleur, batteries)
-
Suivre l’actualité énergétique et les aides disponibles pour la transition.
Glossaire
-
Gaz naturel liquéfié (GNL) : gaz refroidi à -160 °C pour être transporté sous forme liquide par bateau. Il est regazéifié à destination pour être injecté dans le réseau. Plus cher que le gaz acheminé par pipeline.
-
Gaz russe : gaz naturel importé de Russie via des gazoducs comme Nord Stream. Il représentait jusqu’à 40 % des importations européennes avant 2022.
-
Pipeline : conduite permettant d’acheminer des hydrocarbures (gaz, pétrole) sur de longues distances. Moins coûteux que le transport maritime de GNL.
-
REPowerEU : plan européen lancé en 2022 pour réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles russes et accélérer la transition énergétique.
-
Mix énergétique : répartition des différentes sources d’énergie utilisées pour produire de l’électricité (nucléaire, gaz, éolien, solaire, hydraulique…).
-
Marché spot : marché où l’énergie est achetée et vendue pour une livraison immédiate, avec des prix variant selon l’offre et la demande à court terme.
-
MWh (mégawattheure) : unité d’énergie équivalente à un million de watts consommés ou produits pendant une heure. Sert de référence pour évaluer la production et la consommation électrique.
-
Prix marginal : coût du dernier MWh produit pour satisfaire la demande sur le réseau. C’est ce prix qui détermine la valeur de l’électricité sur le marché européen.
-
Centrale à cycle combiné gaz (CCG) : centrale utilisant du gaz naturel pour produire de l’électricité. Très réactive, elle compense les variations des énergies renouvelables.
-
PPA (Power Purchase Agreement) : contrat d’achat direct d’électricité entre un producteur (souvent renouvelable) et un consommateur ou une entreprise, à prix fixe et sur le long terme.
-
Sobriété énergétique : démarche consistant à réduire volontairement la consommation d’énergie sans nuire au confort ou à la performance économique.
-
Autoconsommation : utilisation directe de l’électricité produite par ses propres moyens (ex : panneaux solaires), sans passer par le réseau public.
-
Regazéification : processus par lequel le GNL est réchauffé pour redevenir gazeux avant d’être injecté dans le réseau de distribution.
-
Stockage d’énergie : ensemble des technologies permettant de conserver de l’énergie pour une utilisation ultérieure (batteries, stations de pompage, hydrogène, etc.).
-
Volatilité énergétique : mesure de la variation des prix de l’énergie sur une période donnée. Une forte volatilité indique des fluctuations importantes et imprévisibles.
-
Transition énergétique : passage d’un système fondé sur les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) vers un modèle basé sur les énergies renouvelables et décarbonées.
-
Tarif réglementé : prix de vente de l’électricité fixé par les pouvoirs publics (comme le tarif Bleu d’EDF en France), encadré par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie).
-
Capacité de pointe : production électrique maximale mobilisable pour répondre à une demande exceptionnelle, notamment en hiver.
-
Interconnexion électrique : infrastructure reliant les réseaux de différents pays européens pour échanger de l’électricité et stabiliser les approvisionnements.
Résumez cet article :